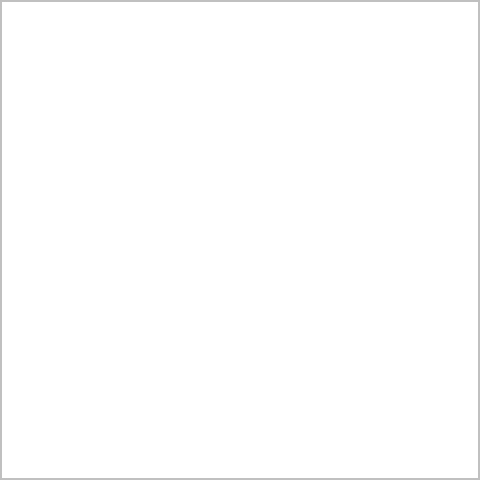Humiliés et offensés, dégradés et déshumanisés, nous nous demandions si nous avions touché le fond de l'abîme.
Humiliés et offensés, dégradés et déshumanisés, nous nous demandions si nous avions touché le fond de l'abîme.
Quelque temps plus tard, ce fut la bastonnade publique d'un évadé repris. Attaché sur un chevalet, il reçut devant tous les déportés - nous étions 2500 - rassemblés sur les deux plus hautes places d'appel un nombre impressionnant de coups de bâton. Comme le détenu chargé de lui administrer la schlague ne frappait pas avec assez de conviction, il fut lui aussi étendu sur le chevalet et cinglé de coups par les chefs SS présents. Il frappa ensuite le malheureux avec violence. Chaque coup me déchirait le cœur.
Je ne distinguai plus la limite entre la terreur physique, que ma volonté pouvait contrôler, et la terreur mentale, face à laquelle j'étais désarmé.
Je faisais corps avec le supplicié. Je sursautais chaque fois que le bâton touchait sa chair. Je partageais sa souffrance, j'étais en lui, j'étais à sa place. Sa douleur était la mienne. Son corps était le mien. Cela dépassait la pitié, la compassion, le « Mitleid », le souffrir-avec. C'est ça l'empathie ! Et l'innommable se produisit. Le mauvais Moi, ce cochon qui sommeille au plus profond de nous, monta en surface. Il me murmura : Ne te laisse pas envahir par tes sentiments. Ce n'est pas toi qui souffres. Puis il se retira. Une immense bouffée de honte m'empourpra. Je m'en voulus d'avoir laissé se déclencher ce mécanisme de défense. A ma honte succéda un diffus sentiment de culpabilité dont je ne me débarrassai plus.
Une fois de plus, je me trouvais en face de cette effrayante complicité, consciente ou inconsciente, entre les bourreaux et les victimes. Je sentais ma dimension humaine fondre et se réduire, je ne vivais plus. Pour la première fois j'eus l'impression qu'un sursis me serait accordé si j'acceptais la soumission, si j'abandonnais mon autonomie, si j'abdiquais ma qualité d'homme. J'éprouvais ce sentiment de honte des enfants et des femmes battus qui reviennent vers leur tortionnaire espérant qu'il a changé entre-temps. Je me déstructurais.