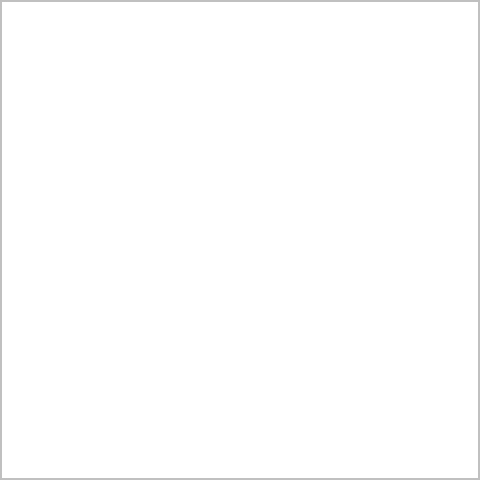Le 20 avril 1945, j’entends l’alerte alors que je suis à l’usine D.A.W, près du camp que je rejoins en fin de journée. Rien d’anormal. On touche notre ration et au lit après un appel de deux heures. Le lendemain, à quatre heures, il faut se lever aux cris du chef de block. Le bruit circule que le camp va être évacué. Tout le monde fait son « bagage ». Nous attendons, errant dans le camp. En guise de repas, nous mangeons avec Chupin un peu de plant de choux que nous avons réussi à prendre dans le jardin des SS.
14 heures 30 : de toute part un cri retentit : « Die Franzosen ! » Je ne suis pas prêt d’oublier cet instant. Quitter le camp, pour moi c’est un peu la liberté, mais peut-être la mort. Il est 17 heures 30. Des Français sont déjà sortis. Nous prenons la queue de ce que je pense être la dernière colonne de nos compatriotes. Nous passons un par un devant une charrette de ravitaillement. Un pain chacun, un morceau de pâté, et un coup de pied dans le derrière par-dessus le marché. Nous sortons de la première enceinte du camp, on nous compte par cent, quatre à cinq fois, puis nous sortons de la seconde enceinte du camp et aux cris sauvages que nous connaissons bien, le convoi s’ébranle. Nous sommes mille hommes. Derrière nous suivent quatre grosses fourragères contenant les paquetages des SS de la colonne. Nous tirons ces voitures, chacun à notre tour.
Quelques heures après avoir quitté le camp, la colonne s’arrête le long de la route. Le lieutenant nous fait un petit discours en quatre points. En cas de bombardements, tout le monde doit se coucher sur place ; nous marcherons une partie de la nuit, car nous n’allons pas assez vite ; désormais, il y aura une cinquantaine d’hommes pour pousser les charrettes ; celui qui s’écartera de la colonne pour ramasser de l’herbe ou autre chose, sera abattu sur le champ.
A minuit, nous entrons dans un village. Nous entrons dans une cour qui ne semble pas bien grande, mais il fait tellement noir que l’on ne se rend pas bien compte. Les gardes nous crient « couchez vous ». Je m’approche d’un tas de paille sur lequel j’étale ma couverture et je me couche. Vers quatre heures du matin, frigorifiés nous battons la semelle, essayant de nous réchauffer. Au jour, quelle n’est pas notre surprise : ce que nous prenions pour de la paille n’est qu’un tas de fumier !