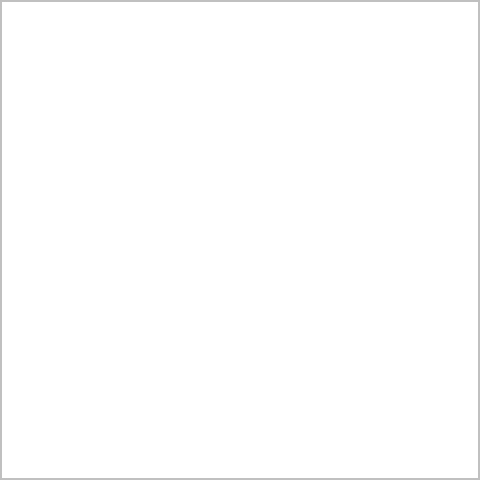Il s'appelait Léo, le soldat canadien qui vint à notre rencontre au coin du petit bois de pins. Il souriait, insouciant de la présence du commandant, des SS, des gardiennes. Il nous aida, les unes après les autres, à monter dans le camion, puis il alluma une cigarette et, tout en chantonnant, il s'assit au volant.
Je ne pense pas qu'aucune de mes camarades puisse se souvenir de son visage ; je n'en ai moi-même retenu que le sourire, premier signe fait par l'univers des hommes au monde des réprouvés.
Je devais souvent évoquer par la suite cette croisée des chemins où quelques individus particulièrement choisis pour leur anormale férocité se trouvèrent face à face avec Léo le Canadien, symbole de l'humanité belle, forte et juste. C'est, du moins, ainsi qu'il fut regardé par le troupeau de femmes exsangues qu'il était venu, ce clair matin de printemps, arracher à la mort, sur les terres maudites de Ravensbrück.
Bien que le voyage du Mecklembourg à Paris ait duré plusieurs jours, la transition s'avéra cependant trop brève pour combler l'incommensurable différence qui nous séparait alors du niveau des humains.
Le comportement de tous ceux qui s'approchaient de nous et nous adressaient la parole nous semblait étrange. En vérité nous ne les comprenions pas. Leur conversation nous paraissait une histoire de fous. Notre essence était désormais différente de la leur. Il n'y avait plus entre eux et nous une différence de degré mais une différence de nature.
Eux n'avaient aucune idée de ce que nous étions. Parce que nous étions maigres, parce que nous avions l'air fatiguées et faibles, deux infirmières soutenaient chacune de nous. Nous nous regardions en clignant de l'œil. Nous avions fort envie de rire, mais nous n'osions pas ; nous ne voulions surtout pas leur faire de peine. Serons-nous toujours aussi prévenantes ?... Nous aurions pu leur dire que trois jours auparavant nous étions encore soumises à un travail forcé quotidien de douze heures et que nous avions passé nos deux dernières nuits au camp, toutes nues, en plein vent. Certes, ils n'auraient pas manqué de s'apitoyer.
« Ils » nous demandent :
- Vous avez beaucoup souffert ?
- Non, c'était supportable.
Déjà le fossé est creusé entre eux et nous. Comment leur expliquer, et à quoi bon. « Ils » disent :
- Nous avons tant pensé à vous.
Nous remercions, polies. Nous aussi nous avons pensé à eux, mais sûrement d'une manière toute différente. A vrai dire, penser à eux n'était qu'une excuse pour penser à nous. Nous ne les imaginions guère qu'en fonction de nous. […]
Maintenant que nous sommes revenues, « ils » nous examinent drôlement. Ce sont peut-être nos vêtements de hasard, nos haillons, qui les choquent. Je crois qu'au fond d'eux-mêmes ils se demandent si nous sommes restées mentalement tout à fait normales, ils entendent si notre jugement est toujours conforme au leur. […]
Mais pourquoi sommes-nous sans cesse poursuivies par l'idée de la mort, de notre propre mort ? Dieu sait pourtant si nous en avons plaisanté ! Un jour que Suzanne et moi étions grimpées sur notre échelle en train de peindre une baraque, nous vîmes passer un vrai cercueil, couvert de quelques branches de sapin et porté respectueusement par trois prisonnières. Le contraste était si surprenant entre le traitement généralement réservé aux cadavres, que l'on jetait en masse dans la charrette mortuaire - le plus vite possible, à cause de l'odeur et de la contagion -, et cette tentative de cérémonie, que nous nous regardâmes, stupides, et saisies à la fois par une incontrôlable envie de rire. Soubresaut provoqué par une tragique bizarrerie ou bravade contre la mort qui guettait de tous côtés ?
Toutefois, n'est-ce pas dans le camp que nous avons pris pour la première fois conscience de notre vie ? En effet, nous sommes constamment en présence du néant, du gouffre, de la mort. Nous sommes privées - faudrait-il dire libérées ? - de nos familles, des conventions sociales, des inégalités qu'elles créaient. Le dépouillement va plus loin que la seule absence de vêtements, de maquillage et autres choses de ce genre. Ce qui importe, c'est notre dépouillement intérieur, intégral, grâce auquel nous prenons enfin et pour la première fois conscience de nous-mêmes.