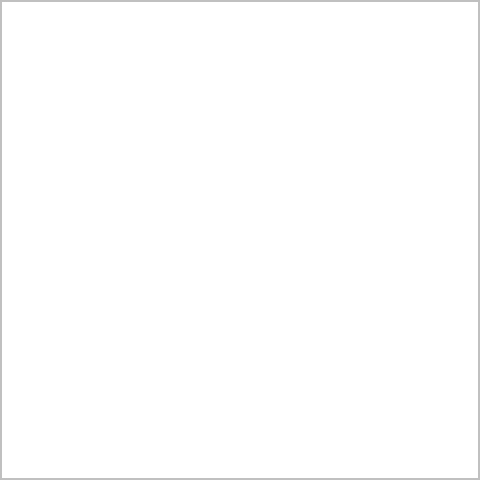L'appel général est grandiose. Nous voudrions alors qu'une bande cinématographique en fixe pour les foules, dont nous supputons le scepticisme, l'aspect colossal et tragique. Or, à moins que la famine ne s'abatte sur l'Europe et ne lui fasse porter le châtiment des crimes nazis, je doute que jamais metteur en scène ne puisse réunir un jour la figuration convenable.
Une heure après le réveil, ululé par une sirène à 3 h 30 du matin, arrivent dans la vaste Lagerstrasse, qui s'étend d'un bout à l'autre du camp, les colonnes rayées de prisonnières. Seules, les Françaises ont encore un aspect un peu vivant, un peu pimpant qui les distingue de cette foule de Cour des miracles où bientôt elles se dissocieront. A peine distingue-t-on les Gitanes aux cheveux noirs, au teint olivâtre, des Allemandes, Russes, Polonaises, Tchèques, Hollandaises, toutes misérables créatures voûtées, comme affaissées sous le poids de l'atmosphère d'épouvante qui pèse continuellement sur Ravensbruck. Les yeux éteints dans un visage osseux, cireux, grisâtre, la bouche entrouverte, elles serrent un petit sac fait de chiffons, une gamelle bossuée sous le bras. Elles grelottent dans le petit matin, mal couvertes par leurs vieux vêtements zébrés, sales, effilochés, les pieds dans des débris de galoches ou de claquettes.
Les plus anciennes portent un incroyable petit bonnet rayé à trois pièces, noué sous le menton, qui les fait ressembler à des serves du Moyen Age. « Ah! dit notre camarade Bella (Denise Dufournier), quand je porterai moi aussi ce bonnet, tu pourras dire que j'ai fini de lutter, que je fais vraiment partie de cette foule, que ma déchéance est complète. ».
Souvent, parmi les pitoyables visages, apparaissent en relief les plus hideux des masques : l'Envie, la Haine, la Luxure, le Vol, le Mensonge, la Calomnie et le Crime.
La Lagerstrasse est remplie de ces colonnes sinistres que les policières rangent avec des injures et des coups qui ne sont pas simulés. Quand tout est en ordre passent rapidement les Aufseherinnen (adjudantes SS) en cape noire sur le costume gris. Elles se rangent elles aussi. Un silence affreux plane lorsque sort de son bureau l'Oberaufseherin (adjudante chef SS) triplement galonnée, celle à qui, sous aucun prétexte, une détenue ne doit adresser la parole. C'est une forte femme sanglée comme une dompteuse dans un tailleur gris à jupe courte et haut bottée. Elle n'a pas de cape, pas de cravate, son col de chemise reste ouvert, même parmi les grands froids. Son calot cascadeur, fortement incliné sur la gauche, laisse échapper à droite une énorme touffe de cheveux roux crépus. Quand elle se rengorge, son menton fuyant disparaît dans son cou et son long nez en trompette pointe entre ses yeux gris et fixes... elle est horrible. Elle évoque l'ogresse toute de mal des contes qui font peur aux enfants. Plus tard, j'ai connu aussi l'Ober d'Auschwitz, au rire de démente, celle qui envoyait d'un signe à la mort ou à la rémission, en s'amusant: « Sympatisch .... Nicht sympatisch.... Sympatisch.... Nicht sympatisch.... » J'ai connu la petite Ober Annie Schmidt aux traits mutins et charmants, que l'ambition transforme peu à peu en monstre...
L'Oberaufseherin parade un stick à la main, prononce parfois une petite harangue aux surveillantes rangées comme de noirs corbeaux devant le bureau (ô Ravensbruck !), puis rentre en balançant ses hanches cambrées. Mais le supplice de l'appel dure encore longtemps après son départ. La mer de visages jaunes et creusés demeure immobile, à peine agitée par l'affaissement des corps mal reposés sur les étroites paillasses pouilleuses sur lesquelles on ne couche alors qu'à deux. Le petit jour naît, blême parfois, ou au contraire rempli de gloire, apportant aux yeux encore capables d'enchantement des lueurs magnifiquement carminées, d'immenses nuages ourlés d'or vif, une aurore sans indécision parée de couleurs surnaturellement pures par la lumière translucide et froide des ciels baltiques. Que nous sommes loin de France !
Ne courbe pas la tête vers cette terre aride qui boit toute sensibilité, lutte encore ; le ciel s'offre à chaque appel. Plus tard, accablée par trop de maux, tu oublieras peut-être le pire, tu oublieras, infortunée, que tu es privée de liberté... Enfin, la sirène déchire l'air, les prisonnières s'ébranlent, sauf celles qui sont désignées pour le travail et qui doivent encore défiler interminablement ; groupe par groupe, devant une bête à lorgnons, la directrice du Travail, puis faire la queue devant les baraques qui contiennent des outils, puis se mettre de nouveau en rangs, bêche ou pioche sur l'épaule, pour partir au pas cadencé vers quelque champ de tourbe ou de sable. Leur marche est rythmée par le chant du « pénitentiaire » qui, chaque jour sur un ordre, doit exprimer sa joie au travail; chant allemand d'où toute mélodie est absente et qui n'est plus que sons saccadés, âpres, désespérés.