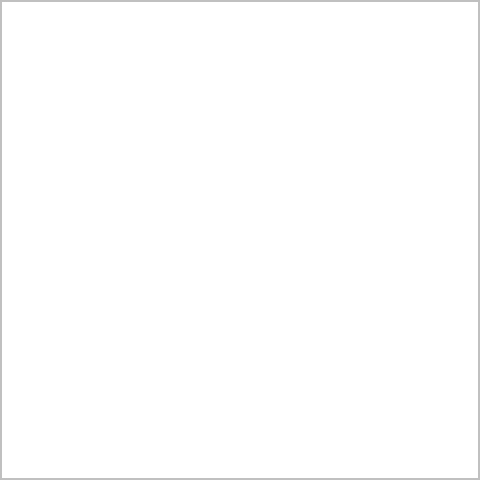Chaque nuit ou presque, nous devons nous lever plusieurs fois. Les hommes n'en peuvent plus. Une compensation serait de pouvoir dormir ou au moins se reposer le dimanche après-midi, après le travail de la matinée. Mais cela se produit rarement, car le block est souvent puni pour une raison plus ou moins futile, si tant est qu'il y ait une raison.
L'après-midi se passe alors en brimades de toutes sortes, telles le « saut du crapaud », les « couchez - levez », poursuivis sur l'Appelplatz jusqu'à épuisement total. Plus tard, pendant le prétendu repos dominical, des équipes sont formées pour décharger à la brouette des péniches remplies de gravats de Berlin. Le soir, nous sommes rompus, anéantis ; le lendemain matin, le travail nous attend à l'usine.
Le drame est là ; épuisé, l'homme ne réagit plus ; ses réflexes sont amoindris. Il s'endort malgré lui, ses gestes cessent d'être automatiques, ses mouvements sont plus lents, le cerveau est de coton... et la main est déjà prise, écrasée sous la presse...
Un certain jour de 1944, j'éprouve une fatigue intense et profonde. Mes yeux se ferment ; le néant s'empare de moi jusqu'au plus profond de mon être. Comme il est difficile de traduire l'immensité de cette détresse physique que tous ressentent ! Il arrive une période où rien ne peut plus rien... Pourtant, combien en avons-nous vu connaître le sursaut et repartir à nouveau vers des espoirs chimériques permettant de survivre quelques heures ou quelques mois...
Très peu n'ont pas connu la défaillance, n'ont pas été contraints de se retrancher, au moins un temps, du monde des valides, malgré le risque terrible qui pesait sur les inaptes. Au Revier, Il faut attendre la visite du docteur. Ce jour-là, c'est l'infirmier qui remplit ces fonctions. Les pauvres types, parqués en rangs par cinq, doivent se tenir immobiles, malgré le froid, le brouillard, la maladie, la fièvre et la souffrance. A chaque appel des malades, si le préposé aux soins voit des hommes non alignés, ou se tordant sous la douleur, il leur tombe dessus, les abat à coups de poing et les frappe à coups de pied lorsqu'ils sont à terre. Je le vois ainsi descendre trois détenus, avant de passer à la visite.
Je touche deux pastilles de tanalbine pour stopper la dysenterie. Je retourne au block 16 où je suis affecté à une table de Schonung (« repos » et travail léger à l’abri, dans une baraque), pour trier des rivets en silence. A midi, nous allons chercher la soupe dans des bouteillons. Les kommandos de travail du camp rentrent et la distribution commence : un demi-litre de soupe et trois pommes de terre. Puis lavage des gamelles et départ des kommandos. Les malades reprennent leur triage de rivets jusqu'à 16 heures. Ensuite, nous allons chercher les rations de pain et de margarine. Puisqu'ils ne sont pas hospitalisés, les malades demeurent astreints à un certain travail.