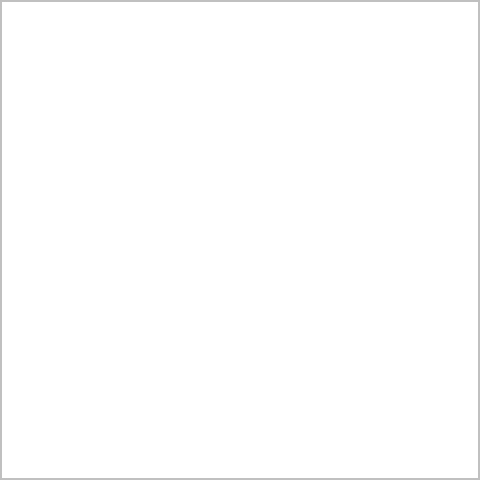C'est le matin. Les soixante-dix punis ne sont pas encore partis au canal. Ils sont dans une courette où ils se tiennent pendant l'appel, isolés du reste du camp. La grande majorité sont des Ukrainiens, les plus maltraités. En nous apercevant, ils crient de contentement comme si nous étions le Messie : « Franzouski ! Spion ! ». Ils savent qu'il y aura désormais plus parias qu'eux pour attirer en priorité les brutalités et les vexations. Nous en avons la cuisante confirmation en cette première journée où je fais équipe avec le docteur Nataf. Il faut charger à ras bord un wagonnet de briques, le pousser en courant jusqu'à la berge et le décharger en faisant glisser les briques dans une péniche sur un fer en U. Nous sommes devenus les têtes de turc de tout le monde : les briques sur les pieds, les coups de schlague sur la tête tombent de partout. Tant et si bien que le lendemain nous nous séparons pour diviser les risques. Mon nouvel équipier est un Allemand, « droit commun » aux yeux pochés, qui me dit : « Je te prends avec moi, tu ne seras pas battu, mais tous les matins tu m'apporteras un bout de ton pain ». Je m'exécute et j'ai quelques jours de répit. Un autre Allemand avec qui je sympathise a vu le marchandage. Il me conseille d'y mettre fin : « En rognant sur ta ration quotidienne tu te condamnes à coup sûr ». J'en suis conscient et je l'écoute. Le « poché » prend très mal mon refus de continuer à le nourrir. Il me saute dessus et nous nous battons comme des chiffonniers. Je vais à un autre chariot sans gagner au change. Cette fois, mon compagnon est un fou, un ancien cuisinier. A intervalles réguliers, il tire de sa poche un chiffon noir de cambouis dans lequel il a émietté son pain, il en prend un grain et le suce lentement en me racontant ses recettes d'autrefois. Je me sens à mon tour devenir fou, je maigris à vue d'œil.
Les deux premiers Français que je vois nous rejoindre portent, fait très rare, un triangle vert. Ils m'évitent mais je tiens à faire leur connaissance, tant je souffre de ne pas entendre parler français. Le tabac nous rapproche. Il est interdit de fumer et nous ne bénéficions d'aucune distribution dans l'aile du block 1 où nous sommes enfermés. Toutefois, l'autre aile est occupée par les boulangers, les détenus travaillant à l'usine à pain toute proche qui ravitaille le complexe de Sachsenhausen. Ce sont des privilégiés et ils ont quelques gestes à notre égard. Au sortir de la courette par laquelle nous passons pour nous rendre au canal, ils laissent tomber des brisures de majorka sur le sol de brique pilée. En passant, nous ramassons furtivement une poignée de poussière et le soir, à plusieurs, nous trions nos petits tas mis en commun. Nous en tirons de quoi rouler un mégot dans du papier journal. Entre deux touches, j'apprends que ces nouveaux viennent de la prison de Dijon. L'un a tué un garde-chasse, l'autre a violé une fillette, qui en est morte. Ce sont des bandits qui ne parlent que de leurs mauvais coups faits et à faire. Je les évite à mon tour.
Puis arrivent de la Strafe de Sachso Roger Agresti, Babine, Inaudi, Debarre ; je tressaille de joie en entendant leur accent marseillais. Pourtant, il n'est pas recommandé de parler français à la Strafe de Klinker. Le chef de block despotique qui joue la plupart du temps avec son bouffon, un nain bossu, nous désigne presque toujours pour les corvées supplémentaires du soir après la soupe. Dans la nuit, nous repartons au canal ; à la lueur insuffisante des projecteurs, nous nettoyons le quai des briques cassées ; nous roulons les dernières bennes, nous nous empêtrons dans les aiguillages (je m'ouvre une jambe en chutant sur une plaque tournante) ; et, lorsque nous rentrons, nous devons encore laver à grande eau la salle des lavabos et y passer la serpillère avant de nous écrouler sur nos paillasses.
Je n'en peux plus, ma jambe s'est infectée. Incapable de pousser un wagonnet, on me met au fond d'une péniche pour empiler les briques qui descendent par le fer en U. Un jour de juin, je crois ma dernière heure arrivée. Un orage a inondé la cale. Je patauge à genoux dans l'eau souillée; la dysenterie me vide et je n'ai pas la force de me relever. Du quai, les SS nous bombardent avec des briques cassées pour que nous nous dépêchions. Le soir, deux camarades me ramènent avec peine au block. Tiendrai-je jusqu'au lendemain ? Oui ! Mais, à l'appel du matin, le chef de block m'interpelle: «Tu n'iras pas au travail aujourd'hui. Prépare tes affaires », et, avec une pointe d'ironie qui me glace, il ajoute à l'adresse du Vorarbeiter: « Il est libéré ». Pendant qu'une camionnette m'emmène au grand camp avec d'autres détenus, je n'ai qu'une pensée en tête : le crématoire. Et puis, à l'arrivée, c'est le miracle !
C'est le fameux intermède qui marque la captivité des « Tunisiens ». Les quarante et quelques inculpés de notre affaire sont rassemblés, douchés, rasés, soignés. Moi-même, qui ne pèse plus que trente-deux kilos, passe entre les mains d'infirmiers qui me pansent la jambe. Remis en état, on nous fait signer un papier où il est dit que nous sommes libérés et où nous nous engageons à ne rien dire de ce que nous avons vu et subi au camp. Nous sommes alors tous embarqués pour la prison berlinoise de l'Alexanderplatz, où nous sommes réinterrogés militairement. Là disparaît à jamais le commandant Tardy, notre chef. Une partie du groupe est astreint au travail obligatoire dans des usines de Berlin. Les autres, dont je suis, sont renvoyés à Sachsenhausen. Nous reprenons nos anciens matricules. Je retrouve la Strafkompanie, mais cette fois au block 13 du grand camp.