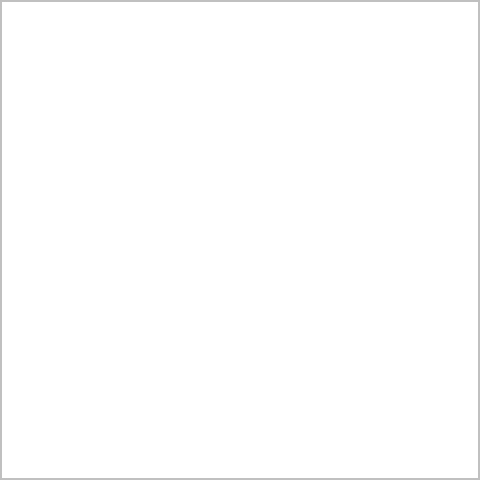(Désiré Hafner a d'abord été interné dans le premier secteur B I du camp de Birkenau, qui devient un camp de femmes à partir de juillet 1943)
L'arrivée à Birkenau donnait l'impression d'une chute brusque, d'un effondrement au creux d'un profond précipice. On sentait le désastre, le cataclysme, mais on ne pouvait croire qu'il serait tellement atroce.
Brutalement, les wagons plombés étaient ouverts par les S.S., et avec des cris sauvages, dans une langue que beaucoup ne comprenaient pas, avec des coups sadiques, les déportés étaient sortis des wagons. Inutile de chercher à prendre avec soi le peu de bagages, le pardessus ou le chapeau. Une pluie de coups t'expliquait que ces choses ne t'appartenaient plus. Après la sauvagerie, le pillage, deux caractères de la vie de Birkenau.
Et, dans la même atmosphère de terreur, nous étions conduits vers le camp. Sur l'entrée du camp les mots fatidiques de Dante « Lasciate ogni speranza, voi chi entrate » auraient dû être gravés, plus que partout ailleurs. Et toujours cette angoisse, cette sensation de chute, de rupture de tout contact avec le monde civilisé.
Ce n'était encore qu'un début. Les S.S. nous livraient à des bandits allemands que le régime hitlérien avait tenu enfermés pendant de longues années et avait préparés en les rendant plus sauvages à la mission de colossale tuerie à laquelle ils étaient destinés.
Ces brutes ont beaucoup souffert pendant les longues années passées dans les différents camps de concentration et parmi eux sont seuls restés en vie ceux qui ont pu assimiler les grands moyens d'extermination appris par leurs renommés maîtres : les S.S.
Ceux qui ont connu ces bandits se sont demandés souvent comment de tels complexes de cruauté, d'inconscience et de cynisme ont pu être réalisés ? Et nous étions livrés à ces tarés, à ces dégénérés qui, tranquillement, calmement, tuaient plusieurs hommes quotidiennement.
Le choc était imprévu et difficilement supportable. Les coups tombaient sans sarrêt sur les pauvres malheureux, des coups lâches, longuement étudiés et qui nous étourdissaient, pour le grand amusement de ces féroces criminels.
Mais dans ce premier jour de notre calvaire, la souffrance morale dominait la souffrance physique. Tout nous était pris, les cheveux coupés, un numéro tatoué sur le bras gauche. Marqués au fer rouge comme les derniers des criminels. Pourquoi ? Pourquoi ces vêtements rayés de bagnards ? Pourquoi ce numéro cousu sur notre veston et sur notre pantalon ?
Aujourd'hui, j'ai compris et approfondi la logique d'Auschwitz et tout esprit de révolte a été détruit en nous ; je ne vois plus dans ce tatouage l'humiliation, mais le moyen le plus sûr d'identification des centaines d'hommes qui, journellement, devaient mourir, le moyen d'identification des cadavres.
Mais, pour le reste de l'humanité, notre numéro tatoué est une preuve que nous revenons de loin, d'un monde incompris et incompréhensible, d'un monde où, mourir dans des souffrances atroces était un devoir, une obligation, et vivre, une anomalie, une exception.
[…] Mais notre premier jour de supplice n'était pas encore terminé. Il fallait assister à un spectacle hallucinant : la rentrée des kommandos du travail.
Qui pourra décrire toute la souffrance que représentait le défilé de tant d'épaves ?
Epuisés par un travail surhumain, battus, en loques, affamés et assoiffés, les milliers de fantômes se traînaient vers le camp. En tête, les derniers arrivés, ceux qui pouvaient marcher encore; et de plus en plus lentement, la grande foule des cadavres de demain, la foule des squelettes vivants d'aujourd'hui.
Le spectacle était bouleversant. Les vieillards épuisés étaient portés par leurs enfants désespérés ; des malades soutenus par ceux qui avaient encore un peu de force, des hommes aux jambes enflées avec des phlegmons énormes ; des crânes ouverts d'où lE sang jaillissait avec abondance. Partout des spectres qui n'avaient plus d'humain qu'une immense douleur, qu'une impuissante résignation.
Jamais tant de souffrances n'ont été rassemblées dans un seul lieu. Une heure, deux heures, le défilé de la mort continuait.
Et puis, jetés l'un par dessus l'autre dans des voitures en bois, mélangés les uns aux autres, des centaines d'agonisants, des dizaines de cadavres. De temps en temps, parmi ces jambes raides, parmi ces poitrines déchirées par les balles, une main ensanglantée remue, un crâne livide, dantesque, se soulève.
Et dans chacun de ces misérables, nous voyons notre image de demain. Dans combien de jours serons-nous aussi comme eux ? Dans combien de jours serons-nous des cadavres ?
Des dizaines et' des centaines d'hommes que ce matin, ont eu encore la force d'aller au travail et qui ont travaillé, encore, ne vivent plus. Comment ? Les hommes ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Tout notre être se révolte contre ce massacre en masse, tout notre être se refuse à croire que les images que nous voyons soient une réalité, et surtout que la mort ici est une loi.
Dans toutes les langues, sur toutes les bouches, la même question revient : « Comment est-ce possible ? ».