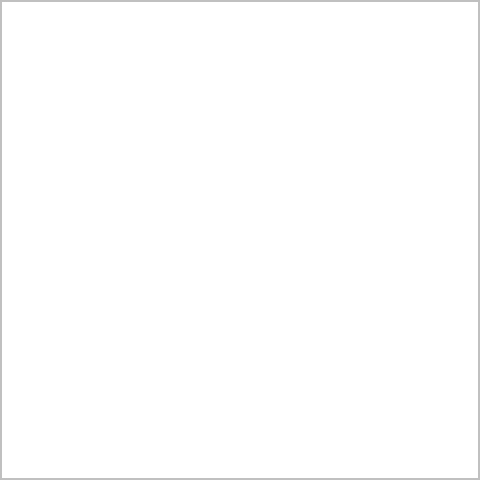Il y a ceux qui se dépêchent d'avaler leur pitance, il y a ceux qui prolongent ce moment pour se donner l'illusion d'avoir plus à manger. J'ai terminé, qu'à côté, un vieil Allemand commence à peine. Penché sur sa gamelle, il est là comme un fidèle qui communierait à la Sainte Table. Il mange lentement, savourant chaque cuillerée. Au fur et à mesure que sa soupe diminue, il va de moins en moins vite ; l'angoisse accentue les traits de son visage. A la dernière cuillerée, il est affreux, ses mains tremblent. Et, quand tout est terminé, sa tête tombe sur sa poitrine et ses yeux se ferment.
Je me souviens d'un autre compagnon, un jeune Lyonnais, fils de soyeux bien élevé, qui, torturé par la faim, dérobe un jour le pain de son voisin. Nous nous en apercevons. Le dénoncer, c'est la schlague : dix coups, vingt peut-être ! Nous ne pouvons pas. Nous essayons de le remettre dans le bon chemin, de l'empêcher de descendre la pente fatale. Je verrai toujours son visage ruisselant de larmes. Cochons de nazis, vous n'aurez pas assez de votre vie pour effacer ces larmes ! Quel affligeant spectacle que celui de l'homme qui tombe !
Combien en ai-je vu de ces camarades avec lesquels j'avais vécu des heures atroces à Compiègne lors de ces redoutables rendez-vous avec la mort, le vendredi, jour où l'on venait chercher les otages à fusiller, avec lesquels j'avais connu ce transport vers Sachsenhausen, puis la quarantaine, et qui, dans le camp, parce que la faim les torturait, se sont dégradés, ont sombré dans la servilité. Et pourtant ils auraient affronté courageusement le peloton d'exécution...
« Mon vieux Couradeau, me dit l'économe du lycée de Poitiers, quand nous serons rentrés, je te ferai déguster du poulet au madère et tu m'en diras des nouvelles. Tiens, je vais t'en donner le secret. On attrape au poulailler un jeune poulet, bien à point. Tu me suis ? Tout vivant, on lui injecte dans les veines une dose de madère. On répète l'opération plusieurs jours de suite ; le sang diffuse l'alcool dans la chair de l'animal; c'est alors qu'on l'exécute. Ah, mon vieux, à s'en lécher les doigts ! »
Tout à son rêve de nourriture, le malheureux ne voit pas qu'il en bave. Moi aussi, d'ailleurs.
Quelques-uns, bien qu'inexorablement détruits par la faim, lui opposent un étonnant mépris et paraissent l'ignorer, toute leur pensée tendue vers une autre obsession. Morel, un ouvrier banlieusard connu à Compiègne, est de ceux-là. Il a une passion : son pavillon et son jardin. Alors que certains, à Sachsenhausen, rêvent de vengeance ou de mangeaille, lui, ne pense qu'à sa petite maison et à ses fleurs. « A cette saison, m'explique-t-il, les anémones sont fleuries ; j'en ai une bordure autour du pavillon ; si tu voyais ce mariage de bleu et de rouge ! Mes glaïeuls sont plantés pour la floraison de fin d'été ; j'alterne le blanc, le violet, le jaune, le rose et le rouge. Quant aux campanules, j'en ai fait des corbeilles, tu verras ! Je te couperai un bouquet de giroflées. Quel coloris, quel parfum ! »
Brave Morel, il est intarissable et c'est merveilleux de considérer, qu'ici, dans ce camp, un homme puisse encore parler de fleurs et les aimer. « Mes tulipes, mes tulipes ... ». Ses yeux se ferment, son esprit vagabonde ; il s'évade. Et puis, tout d'un coup, revenant à la tragique réalité, il ajoute : « C'est impossible que les SS aiment les fleurs ». Morel qui déteste la soupe de rutabagas, n'en mange jamais. Il la distribue autour de lui. A ce régime, il ne risque pas de tenir longtemps. Atteint de dysenterie, il est conduit au Revier, où il est placé près d'une fenêtre. Tous les soirs, après la sortie de l'usine, nous allons le voir et, par signes, au travers de la vitre, nous conversons. Dans sa courte agonie, Morel ne sera jamais seul. Tout autour de lui, il y aura ce magnifique parterre de fleurs qui lui fait garder son beau sourire. Chaque jour qui passe l'épuise davantage ; bientôt seule sa tête peut bouger. Un soir, le lit est vide. Morel est mort...
Force est bien d'admettre que les Morel relèvent de l'exception qui force à la fois l'admiration et la tendresse. La démarche commune, observée partout, celle imposée par les viscères, c'est de s'ingénier à calmer la faim, alors que la faim est omniprésente et que les moyens de la réduire, pratiquement inexistants, sont convoités par le plus grand nombre.