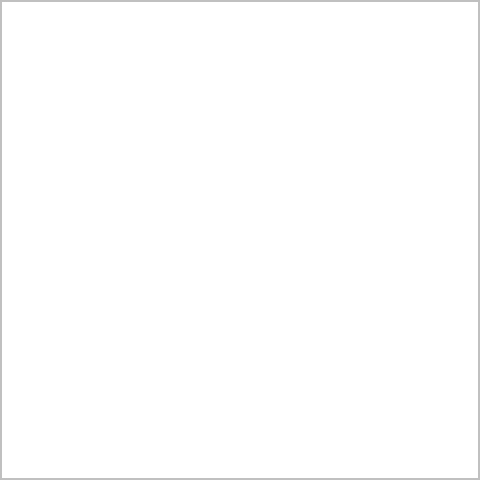Comment décrire un quart de siècle après, les événements que l’on a vécus et qui furent d'une densité telle que même leur évocation semble enlever leur authenticité ? Comment les décrire sans tomber dans l’emphase et la grandiloquence ?
Comment décrire un quart de siècle après, les événements que l’on a vécus et qui furent d'une densité telle que même leur évocation semble enlever leur authenticité ? Comment les décrire sans tomber dans l’emphase et la grandiloquence ?
Comment décrire la joie de résurrection quand elle est mêlée au goût des cendres du crématoire où tant d'être que vous avez connus ont laissé leur vie ?
J’écris pour vous, mes camarades, et je vais rapporter mes souvenirs personnels, peut-être trop dépouillés de sentiment, mais je suis sûr que chacun de vous à l’évocation de ses propres souvenirs, va y ajouter une note affective.
Décembre 1944.
Depuis le débarquement en juin, on passait par des stades de l’espoir - les nazis vont capituler, il y a eu un attentat contre Hitler, il y aura une révolution en Allemagne - et de morne tristesse - on nous a oubliés, les Alliés s’en fichent, pourquoi les Russes n'attaquent-ils pas de l’autre côté...
Les optimistes annonçaient dès le mois de juillet qu’on passerait Noël chez nous.
« Si les petits cochons ne nous mangent pas », car l'humour nous aidait à vivre.
Et voilà décembre et nous sommes toujours là.
Nous ? Pas tous...
Les nouvelles nous parvenaient par les détenus qui, travaillant chez les S.S., ont pu écouter la radio ; ou bien elles naissaient on ne sait comment, parfois le fruit d’une intense envie de vivre, de survivre.
Cette fois-ci les bruits qui couraient paraissaient se vérifier - les Russes ont commencé leur grande offensive.
Au mois de janvier, on entendait déjà le canon.
L’Organisation Clandestine du camp s’est réunie et on a envisagé toutes les possibilités. Le camp va être évacué, sauf les grands malades qui vont probablement être exterminés. Doit-on essayer de rester ? Peut-on envisager une résistance ?
Après quelques discussions, on a laissé à chacun la liberté d’agir, car cette décision pouvait signifier la vie ou la mort.
La majorité cependant a décidé de tout faire pour ne pas se laisser évacuer.
Le 18 janvier, l’ordre d’évacuation est arrivé. Tout le camp devait partir, y compris le personnel du Revier.
Seuls les grands malades devaient rester avec deux médecins que l’on a désignés.
Tard dans la nuit on a fait le rassemblement pour le départ.
Notre Blockältester Karl, un communiste autrichien, ne s’est pas présenté, à l’appel et ne nous a pas forcé à le faire.
Le lendemain matin, le camp présentait un aspect toujours sinistre, mais inhabituel.
Personne dans les allées entre les blocks, pas un bruit, mais des SS toujours dans les miradors.
On s'attendait à chaque instant à « l’action terminale » et on préparait nos plans.
La nuit, on a installé une permanence dans un block vide d’où on pouvait guetter les arrivées.
Le jour, on s’enhardissait et on sortait. On vivait intensément chaque instant, car on pressentait la fin du cauchemar. La liberté ou, la mort. Mais pas une mort dans une chambre à gaz.
On a fracturé la Bekleidungskammer et on s’est habillé en civil.
On a pénétré dans le sacro-saint magasin bourré des victuailles pour les SS et on a apporté des provisions aux malades.
Quelques SS descendaient encore dans le camp et c’est ainsi qu’un officier SS a tué d'une balle de, revolver un médecin hollandais qu'il a surpris dans les cuisines.
Le 23, les SS des miradors ont été remplacés par de vieux soldats de la Wehrmacht. Ceux-là ont fait un tour dans le camp, mais quand ils ont vu nos cadavres, vivants et morts, ils ont vite regagné leurs miradors.
Il n’y avait plus d’électricité au camp et les fils barbelés ne nous menaçaient plus d’électrocution.
Le 25, les miradors étaient vides. On n'était plus gardé.
Le même jour, je suis sorti du camp en portant sur, une civière, un détenu gravement malade, un prêtre polonais, avec lequel je me suis réfugié chez un cheminot, dans la ville
d’Oswiecim, devenue en langue allemande le sinistre Auschwitz.
Tout le long des trois kilomètres qui séparaient la ville du camp, nous avons rencontré des convois de troupes en retraite.
Le 27, j’ai vu la première patrouille russe pénétrer dans la ville, suivie de soldats en rang serré.
Un seul sentiment m’a envahi. Entièrement, égoïstement, impérieusement.
Je ne suis pas mort ! Je suis parmi ceux qui ont survécu et qui pourront témoigner.
Je suis vivant, vivant, vivant...