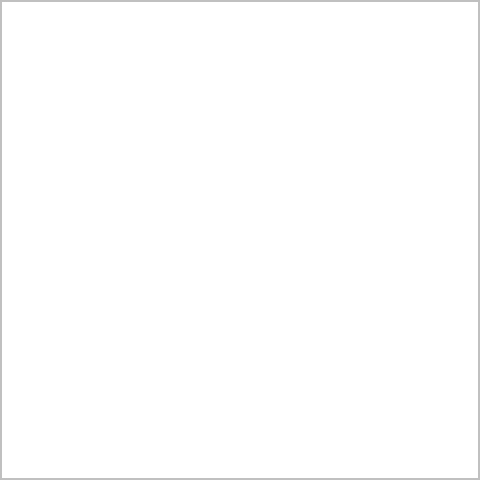Je crains qu'aucun récit ne puisse jamais exprimer le choc que la mise en scène de cette arrivée produisit sur nous. D'énormes projecteurs nous firent passer sans transition de la nuit la plus complète à une lumière aveuglante; mais cette lumière était sans doute savamment combinée afin de le désorienter le plus possible nos esprits. Des zones de clarté intense alternaient avec des zones d'obscurité totale, de sorte que l'on était frappé par une espèce d'incompréhension et qu'en dehors des premiers plans agrandis on ne pouvait à peu près rien deviner de la disposition des lieux.
Je crains qu'aucun récit ne puisse jamais exprimer le choc que la mise en scène de cette arrivée produisit sur nous. D'énormes projecteurs nous firent passer sans transition de la nuit la plus complète à une lumière aveuglante; mais cette lumière était sans doute savamment combinée afin de le désorienter le plus possible nos esprits. Des zones de clarté intense alternaient avec des zones d'obscurité totale, de sorte que l'on était frappé par une espèce d'incompréhension et qu'en dehors des premiers plans agrandis on ne pouvait à peu près rien deviner de la disposition des lieux.
Une immense porte, ouverte, derrière laquelle était levée une barrière de fer, tenant à la fois du passage à niveau et de la guillotine, encadrée de deux bâtiments verts devant lesquels des soldats montaient la garde, nous engloutit rang par rang.
D'autres surprises nous attendaient; on nous dirigea vers une sorte d'avenue sans arbres, mais bordée de lampadaires allumés. Quel fut notre ahurissement quand nous aperçûmes des créatures étranges, vêtues de robes et de jaquettes rayées, coiffées de bonnets à trois pièces, également rayés, qui circulaient deux par deux en portant ce qui semblait être des cuves ? Étions-nous devenues subitement folles ? Était-ce le jour ou la nuit ? A quel exercice se livraient ces êtres bizarres, pliant sous le poids trop lourd de leur charge ?
Un groupe de ces silhouettes attendait pour nous laisser passer. Nous pûmes distinguer leurs visages : ils étaient faméliques, impassibles ; leurs yeux, hagards, sortaient de leurs orbites. Les corps informes, si maigres, évoquaient par leur galbe les statues du Moyen Age qui ornent les portails de nos cathédrales. J'en vis qui nous montraient du doigt en grimaçant un rire diabolique.
Je sentis naître en moi la panique, une sorte de terreur, comme celle que causent aux enfants les récits des légendes nordiques peuplées d'êtres fantastiques qui tiennent à la fois des dieux, des hommes et des bêtes. De même qu'on éprouve alors le besoin de se cacher la tête sous un oreiller bien chaud, je sentis le besoin de regarder mes voisines, de m'assurer qu'elles étaient là, bien vivantes. L'étonnement nous coupait la parole.
Puis cette sensation de cauchemar fit place .chez moi à une extrême curiosité : notre file poursuivit son chemin dans des allées plus obscures, passant devant des baraques éclairées; des silhouettes aperçues par les fenêtres donnaient à penser qu'on y vivait comme en plein jour.
Dans un coin, trois ou quatre femmes rayées - car c'étaient des femmes - se précipitèrent à notre rencontre; elles regardaient autour d'elles pour s'assurer sans doute que personne ne les observait et elles crièrent : « Vous êtes Françaises, « nouvelles » ? Nous aussi nous sommes Françaises. Mangez toutes vos provisions. On prend tout. »
De ce dialogue hâtif entre les anciennes et les non-initiées, les profanes, les « nouvelles », comme elles nous appelaient, ressuscitant ainsi sans en mesurer toute l'ironie nos souvenirs d'écolières, il émanait quelque chose d'inconnu, une sorte de malédiction. Notre surprise était à son comble. Mes yeux enfin s'ouvraient à la réalité: nous étions tout simplement dans un bagne.
Nous traversâmes tout le camp jusqu'au block 26. Le besoin d'un lit se faisait sentir, de plus en plus violent. Cette fois encore, une déception nous attendait : on nous poussa "à l'intérieur de cette baraque dans une seule pièce, si petite que nous fûmes obligées de rester debout, serrées les unes contre les autres. L'atmosphère était irrespirable. Les malaises commencèrent. Celles qui s'évanouissaient n'avaient pas la place de tomber et s'appuyaient sur leurs voisines, inertes. Quand nous voulûmes ouvrir les fenêtres, des prisonnières à brassard rouge, signe distinctif des policières, s'y opposèrent, sous prétexte de défense passive, et nous menacèrent de faire entrer les chiens, dont nous entendions les hurlements à l'extérieur. Il n'y avait que quatre W.-C. et il était impossible d'y accéder. L'air était plus frais dans le couloir, mais c'était un tel brouhaha et une telle bousculade qu'il était préférable de ne pas bouger. Nous apprîmes que nous devions passer toute la nuit dans ces conditions. Nous nous regardâmes stupides. Avait-on pour but de nous asphyxier ?