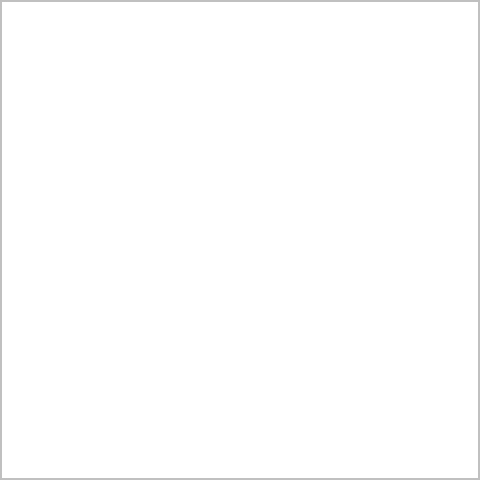Notre départ pour le kommando est décidé très vite. Irruption de la police du camp : « Tout le block dehors, Raus, Raus, Schnell, Schnell, Los, Los », coups de pieds, coups de bottes, cris, hurlements. Cinq par cinq, tout le monde au Revier (infirmerie). Simili visite médicale, nouveau prétexte à l'exhibition du troupeau de prisonnières nues devant les S.S. narquois. Une partie est désignée pour le transport, l'autre reste. Sur quoi est basé le choix ? nous l'ignorons. Vaut-il mieux quitter l'enfer de Ravensbrück ou aller se faire bombarder dans un kommando ?
Mon destin est fixé : ma camarade de paillasse et moi, nous sommes désignées pour le transport. Les bruits commencent à courir : nous devons partir pour une usine de gâteaux dans le Hanovre. C'est ce que dit la liste officielle, car d'après les dossiers de Ravensbrück, jamais les prisonnières politiques n'ont travaillé pour la machine de guerre allemande. Mais l'avenir devait nous montrer que les usines d'alimentation (Lebensmittelfabrik) se transformaient vite en poudreries, en usines de V l, de Heinkel ou de masques à gaz.
Pour ce voyage sans bagages, nous retrouvâmes nos wagons à bestiaux. Nous mîmes deux jours et une nuit pour faire le dérisoire trajet Ravensbrück-Hanovre, en pleine chaleur de juin, sans eau, sans air, sans paille, entassées et accroupies dans la poussière de charbon du chargement précédent. Ce n'était rien, mais ce qui fut terreur et humiliation, c'est tout ce qui se rapportait à un certain seau en émail rouge qui pendait au plafond en se balançant au-dessus de nos têtes. Nous ne dûmes en user que rarement et seulement après autorisation du grand diable de S.S. chargé de garder le wagon, qui se délectait et augmentait encore notre gêne en assaisonnant le tout de commentaires et de grossièretés.
A notre gare de débarquement, Hannover-Linden, les directeurs de l'usine, gros Allemands bedonnants, avec un grand renfort de police, vinrent prendre livraison du bétail français avec un air satisfait et vainqueur.
La baraque de bois qui servait d'Arbeitslager avec ses nombreux barbelés électrifiés, était au pied de l'usine, sur l'emplacement d'un block incendié par un bombardement ; témoins en étaient encore les poutres calcinées et les barres de fer tordues. Des six cents Ukrainiennes qui nous avaient précédées à l'usine, pas une n'avait survécu.
Notre vie à l'usine commença, vie abrutissante et éreintante s'il en fût : douze heures de travail à la chaîne, une semaine de jour, une semaine de nuit. L'apprentissage est dur : il faut suivre le rythme d'un tapis roulant, prendre des formes de fonte de trois kilos à la cadence de trois par minute, et cela de six heures du matin à six heures du soir, ou de six heures du soir à six heures du matin. Les contremaîtres ne sont pas patients ; nous ne mettons pas de bonne volonté pour leur fabriquer leurs masques à gaz. Lorsque les « souris » s'en mêlent, cela se termine toujours par des coups de botte et des coups de poing qu'il faut recevoir stoïques, au garde à vous, les poings serrés, la rage au cœur. Le spectacle est tel que les civiles allemandes qui travaillent dans notre atelier ne veulent plus être témoins de scènes pareilles ; on se contentera désormais de relever notre numéro et le compte sera réglé au camp ; nous n'y perdrons pas. Je me rappelle en particulier le cas d'une petite Française de 18 ans sur laquelle une S.S. s'est acharnée une nuit et qui ne fût lâchée par sa tortionnaire que lorsqu'elle fût étendue par terre inanimée.
A part ces incidents, le travail s'écoule lent, monotone, endormant. L'atmosphère de l'atelier est irrespirable : émanations de benzine, de caoutchouc ; souvent la température atteint 35°, pas moyen d'aérer à cause de la défense passive, seuls deux ventilateurs remuent l'air ; nous nous asphyxions lentement. Par bonheur, des alertes, de plus en plus nombreuses les derniers mois, créent un peu de diversion. On nous fait descendre dans les abris, car livrées à nous-mêmes, nous en profiterions sans doute pour prendre la clef des champs ou pour saboter leurs précieuses machines. Mais les différences de température sont effroyables. Nous quittons notre étuve pour nous réfugier dans les caves glaciales de l'usine. Nous avions essayé de parer au danger en nous fabriquant des plastrons de carton que nous glissions sous notre robe rayée. Effort inutile : « l'Araignée et la Carabosse » eurent vite découvert notre ruse, car chaque fois qu'elles nous frappaient elles sentaient la résistance de notre carapace.
Au bout, de quelques mois, nous effectuons notre travail comme des automates, mais notre pauvre tête a le temps de divaguer et c'est toujours l'idée du retour qui l'obsède. Ne va-t-on pas perdre la raison ? Rien ne rompt la monotonie de notre vie de forçats ; la soupe de rutabagas à midi et le petit morceau de pain le soir sont les objectifs auxquels on songe ; souvent nous tombons d'inanition avant l'heure de la distribution.