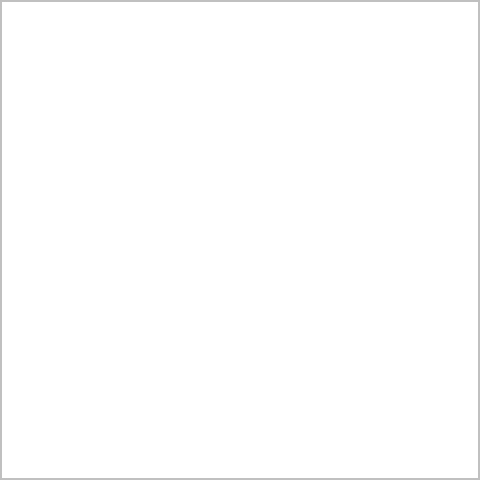Tout ce qui pouvait ressembler à un travail manuel, à un jeu, à une lecture, était sévèrement interdit. Nous étions de la marchandise entreposée, la marchandise ne s'amuse pas, elle ne pense pas, elle ne souffre pas. Seule distraction autorisée, l'arrivée de la soupe. On l'apportait après une éternité de vide et d'ennui : il pouvait être dix heures et demie du matin. Selon les jours, c'était du rutabaga orange ou de la betterave rouge. Souvent elle était généreusement agrémentée de cumin. L'ennui, à cette époque était encore plus fort que la faim, et la cuve aux déchets débordait de laissés-pour-compte. Et l'après-midi se traînait, interminable, dans un relent de rutabaga. Le ronron des conversations enflait jusqu'à devenir un ronflement énorme qui empêchait toute pensée ; on était trop mal installée pour dormir ; à cinq ou six mètres de soi on apercevait un visage ami, mais pour parvenir jusque-là, il eût fallu se dégager de dessous les personnes assises sur vous, en enjamber et en écraser quelques autres, soulever une tempête de protestations... Alors on renonçait, on restait à la place que le hasard vous avait donnée, avec le sentiment désespéré du temps perdu. Comme suprême ressource contre l'ennui, restait la queue au lavabo. Vers cinq heures enfin, le seul repas intéressant de la journée : une soupe au gruau, généralement chaude, deux cent cinquante grammes de pain noir et, selon les jours, de la margarine, une bouchée de pâté ou une cuillerée de confiture. Mais le seul instant réconfortant de la journée était interrompu par la sirène. Il faut se précipiter dehors pour l'appel du soir, même cérémonie que le matin, mais encore plus déprimante. [...]
Tout ce qui pouvait ressembler à un travail manuel, à un jeu, à une lecture, était sévèrement interdit. Nous étions de la marchandise entreposée, la marchandise ne s'amuse pas, elle ne pense pas, elle ne souffre pas. Seule distraction autorisée, l'arrivée de la soupe. On l'apportait après une éternité de vide et d'ennui : il pouvait être dix heures et demie du matin. Selon les jours, c'était du rutabaga orange ou de la betterave rouge. Souvent elle était généreusement agrémentée de cumin. L'ennui, à cette époque était encore plus fort que la faim, et la cuve aux déchets débordait de laissés-pour-compte. Et l'après-midi se traînait, interminable, dans un relent de rutabaga. Le ronron des conversations enflait jusqu'à devenir un ronflement énorme qui empêchait toute pensée ; on était trop mal installée pour dormir ; à cinq ou six mètres de soi on apercevait un visage ami, mais pour parvenir jusque-là, il eût fallu se dégager de dessous les personnes assises sur vous, en enjamber et en écraser quelques autres, soulever une tempête de protestations... Alors on renonçait, on restait à la place que le hasard vous avait donnée, avec le sentiment désespéré du temps perdu. Comme suprême ressource contre l'ennui, restait la queue au lavabo. Vers cinq heures enfin, le seul repas intéressant de la journée : une soupe au gruau, généralement chaude, deux cent cinquante grammes de pain noir et, selon les jours, de la margarine, une bouchée de pâté ou une cuillerée de confiture. Mais le seul instant réconfortant de la journée était interrompu par la sirène. Il faut se précipiter dehors pour l'appel du soir, même cérémonie que le matin, mais encore plus déprimante. [...]
Je ne sais si ce régime, appliqué aux Allemandes, Ukrainiennes et Polonaises, réussit à faire d'elles des bêtes inertes. Les Françaises, elles, s'y refusèrent. Au bout de très peu de temps, elles s'ingénièrent à agrémenter ces journées mortelles. Elles flairèrent vite la façon de prendre la surveillante du block et ses adjointes, la « Blockowa » et les deux « Stubowa », pour employer la terminologie germano-polonaise en vigueur. La « Blockowa » était une Allemande élevée en Amérique, commerçante à Berlin et condamnée pour trafic de devises ; des « Stubowa », l'une était une dame polonaise et l'autre la femme d'un consul tchèque. Les trois étaient énergiques et intelligentes, elles avaient l'expérience de la vie et surtout de la vie de camp ; bien que leurs nerfs fussent détraqués par trois ou quatre ans de détention et qu'elles se missent à crier pour un rien, elles avaient gardé leur jugement et le sens de leurs intérêts. Elles virent vite que le seul moyen d'avoir la paix était de nous laisser exercer librement nos petits jeux en veillant simplement à c e qu'il n'y eût pas de scandale public.
Le block 13 était bourré d'objets illicites, qui peu à peu remontèrent à la surface : on retoucha les robes rayées à coups de foulards et de ceintures antiréglementaires. Les têtes rasées s'ornèrent de turbans. Un jour, à l'appel, cela nous valut les premiers démêlés avec notre « souris » (c'est ainsi que nous appelions les « Aufseherinnen » : elle arracha une demi-douzaine de coiffures et distribua force gifle en criant :
« Qu'est-ce que c'est que ces turbans ? Vous vous croyez donc chez les Chinois ? ».
On fut plus prudentes, mais les accessoires de toilette n'en acquirent que plus de valeur. On vit surgir des jeux de cartes, de la laine à tricoter, on défit son chandail pour le plaisir de le refaire. Tous ces divertissements étaient encore rarissimes, il fallait attendre des heures son tour de cartes ou d'aiguilles : mais la journée avait acquis un but et ces futilités redonnaient un prix à l'existence. Le dimanche, après la cuillerée de confiture qui marquait cette heureuse journée, on lisait la messe, puis du côté B une femme pasteur célébrait un service protestant. Les non-croyantes n'étaient pas les dernières à apprécier cette précieuse heure de silence. La « Blockowa » voyait d'un œil favorable les chanteuses, les conférencières qui, elles aussi, calmaient pour un instant l'effroyable chahut des conversations. Le dimanche soir, la « Blockowa » organisait une petite mondanité : nous eûmes une policière à nez pointu qui jouait de l'harmonica ; deux petites Allemandes chantèrent des chansons sentimentales, une walkyrie tchèque lâcha d'une voix tonitruante, les opéras de Smetana. Un soir, une femme très brune, très belle, se dressa devant le placard aux gamelles et sa seule attitude créa en moi le souvenir d'une salle de concert et la vision de cette même femme debout devant un piano à queue. Elle chanta avec infiniment d'art du Mozart, du Fauré, du Reynaldo Hahn. C'était une cantatrice connue de Paris, rescapée d'Auschwitz. Ce fut ma soirée la plus belle de Ravensbrück, la plus cruelle aussi par tout ce qu'elle évoquait du passé. Je compris à la fois la nécessité et l'inanité de nos efforts pour vivre, devant la machine impitoyable qui allait nous broyer.