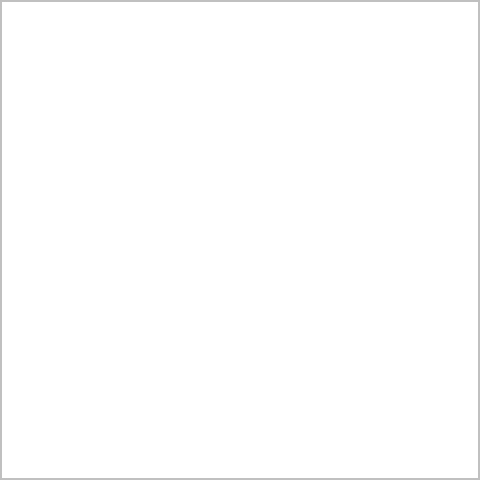Les wagons du train immense ne comportaient pas même de paille. Après une nuit pénible, on nous débarquait à Leipzig Schönefeld. Les mille Gitanes avaient disparu en cours de route. Les ruines de l'usine Hasag étaient situées à l'extrême limite de la banlieue, tout contre la campagne. Une alerte salua notre arrivée ; nous eûmes le temps de voir la panique folle des civils qui couraient avec leurs paquets se terrer dans les cultures. Nous comprîmes leur terreur quand le lendemain nous visitâmes l'usine : grosse affaire de construction mécanique transformée en usine de munitions. Les Anglais l'avaient réduite à néant à la Pentecôte. On nous envoyait pour la remonter.
Les wagons du train immense ne comportaient pas même de paille. Après une nuit pénible, on nous débarquait à Leipzig Schönefeld. Les mille Gitanes avaient disparu en cours de route. Les ruines de l'usine Hasag étaient situées à l'extrême limite de la banlieue, tout contre la campagne. Une alerte salua notre arrivée ; nous eûmes le temps de voir la panique folle des civils qui couraient avec leurs paquets se terrer dans les cultures. Nous comprîmes leur terreur quand le lendemain nous visitâmes l'usine : grosse affaire de construction mécanique transformée en usine de munitions. Les Anglais l'avaient réduite à néant à la Pentecôte. On nous envoyait pour la remonter.
J'ai donc connu la Hasag de Leipzig au moment où elle n'était qu'un petit « Arbeitslager » de deux mille femmes environ. Nous logions dans un ancien corps d'atelier tout en hauteur, chose terrible quand on n'avait plus pratiqué d'escalier depuis cinq mois. L'administration était toute entre les mains d'un groupe de Polonaises, et je dois dire que c'est la seule fois de ma captivité que j'ai touché, avec le minimum de bagarres, une quantité suffisante de victuailles appétissantes. Il paraît d'ailleurs que cela ne dura pas. L'ennuyeux, c'était qu'il nous fallait des chefs de chambre parlant à la fois l'allemand et le polonais, et les seules détenues qui remplissaient ces conditions étaient des femmes de mineurs belges ou françaises, d'une mentalité et d'une moralité lamentables. Pour une vétille, elles livraient leurs femmes aux fureurs du Commandant et de 1'« Oberaufseherin », jeune couple splendide ayant la matraque leste. A l'appel, et toute la journée on vivait dans le bruit de tonnerre des essais de munitions ; car on avait remonté quelques ateliers qui fabriquaient des bombes. La plupart des femmes y faisaient un dur travail d'homme. Le hasard versa mon groupe dans une équipe de déblaiement.
Chose extravagante, ces douze heures de terrassement m'ont laissé un souvenir lumineux, tant était grande la joie de se donner du mouvement au grand air et de sentir son corps jouer normalement. On nous avait repris les vestes et les bas, et lors de la première séance nous fûmes trempées jusqu'aux os. On nous faisait lever à quatre heures et demie, mais les contremaîtres n'arrivaient qu'à six heures et demie, de sorte que nous avions le temps de geler vives sur le chantier avant le lever du soleil. Dans la journée, il faisait torride et nous étions couvertes de coups de soleil. Malgré tout, je ne détestais pas de manier la pioche et la brouette ; la « planque », très demandée, consistait à débarrasser les briques des restes de ciment, à petits coups de marteau ; ce que j'ai fait de pire, c'est l'arrachage des lattes d'un immense parquet collé sur un fond de bitume.
Actuellement, dans ma ville, il y a des prisonniers de guerre allemands qui font exactement le même travail, et je les observe en connaissance de cause : ils travaillent sur un rythme infiniment moins dur et moins précipité que le nôtre.