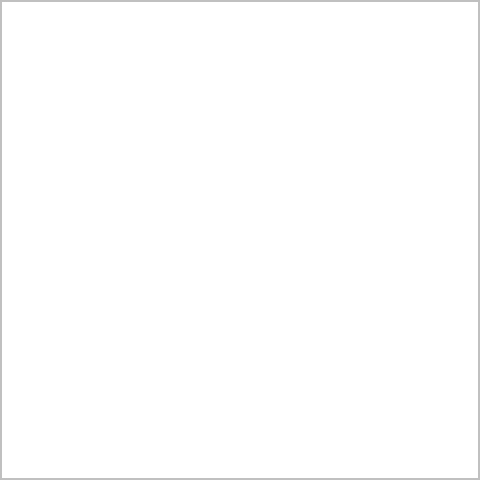Les mardis et vendredis sont pour moi les jours de « cauchemar ». Ce sont les jours de pansements. Ils sont tous faits devant le docteur, sur la table de la salle d'opérations. Rares sont celles qui peuvent marcher jusque-là. Nous devons les porter, les traîner à deux infirmières, et c'est pour moi un calvaire, chaque fois. Ces corps épuisés, gémissants, qu'on ne sait par quel endroit saisir, dont les plaies coulent, qui ont si souvent de telles diarrhées qu'il faut porter le bassin d'une main, en les soutenant de l'autre. Ces pansements faits en série, à l'appel du numéro, sans contrôle préliminaire, sur des êtres qui mourront une heure après. Il m'est arrivé de porter péniblement, à travers les rangées de châlits trop serrés, des malheureuses n'ayant même pas la force de gémir, et de me demander si elles arriveraient vivantes sur la table de pansement.
Les malades que nous transportons sont parfois nues. Nous n'avons pas assez de linge, et les chemises sont si souillées que nous ne pouvons pas les leur laisser.
Pour aller du dortoir jusqu'à la table d'opérations, nous devons traverser le Tagesraum. Là, bavarde, rigole, mange le personnel indifférent du block, Stubova et ses acolytes, les Dienstzimmer, entourées de leurs amies préférées. Là aussi, écroulées ou assises par terre, attendent patiemment, pendant notre lamentable défilé, les « entrantes », qui doivent prendre place au dortoir, quand les pansements seront terminés. Triste vision pour celles qui ne sont pas aveugles d'épuisement et qui sont destinées à être opérées le lendemain.
Il m'est arrivé d'être appelée pour assister le docteur.
Toutes les anesthésies sont très courtes, et, lorsque l'opérée n'a rien aux membres, elle est secouée, réveillée brutalement, mise debout et poussée hors de la pièce. Là, titubante comme une femme ivre, elle doit regagner son grabat.
Les amputées sont transportées par une infirmière qui, souvent, elle-même épuisée, porte péniblement son fardeau...
J'apprends que je suis changée de service et dois passer aux infectieux. Je quitte sans regret ce block où le travail est épuisant, et les résultats si peu encourageants... mais considère avec stupéfaction mon nouveau service : la scarlatine.
Un long corridor de un mètre soixante-dix de large. Des grabats par terre et des femmes couchées comme des sardines dans une boîte, serrées les unes contre les autres, toutes de côté sur une hanche, dans l'impossibilité totale de bouger.
Je ne peux pas entrer sans enjamber des corps et mettre mes pieds de travers, entre une fesse et un ventre emboîtés. Je ne peux que difficilement ouvrir la porte et confie aux premières malades le soin de transmettre le thermomètre aux suivantes.
Une petite fenêtre éclaire, au bout du corridor, cette série de malheureuses qui manquent d'air et ne peuvent bouger.
Une grande Hollandaise de vingt ans n'a jamais pu s'allonger complètement ; elle mesurait un mètre quatre-vingts et devait vivre les jambes pliées, constamment rabrouée par ses voisines, parce qu'elle rentrait ses genoux dans leurs reins.
Les soins sont réduits au minimum : quelques cachets distribués sans discernement par le docteur qui répugne à entrer parmi les malades et donne au hasard des demandes...
Désirant réduire les chances d'épidémie, les autorités exigent que soit respecté le délai de quarante jours, et c'est dans ce réduit immonde, jamais nettoyé, où mangent, dorment, souffrent toutes ces scarlatineuses, que doivent se passer les longues heures de celles qui, depuis longtemps convalescentes, attendent que leur soit indiqué leur jour de sortie. Et tant est atroce la vie du camp, ce terrible appel du matin, que j'ai vu certaines femmes tricher en prenant leur température, faire monter leur fièvre, pour ne pas quitter « la Boîte à Sardines » et, ainsi, retarder le jour où elles devront reprendre le collier de misère du travail.
Je dois également soigner les diphtériques.
Chambre carrée de quatre mètres sur quatre. Les châlits sont à deux étages, comme toujours, et deux malades par paillasse.
Dans la pièce voisine sont les typhiques, et je m'aperçois avec étonnement que nous devons nous servir des mêmes thermomètres. Je dois les remettre matin et soir à ma collègue. Elle me les rend après usage.
Lorsque les malades viennent de notre camp et que les diagnostics ont été rapidement faits, la guérison est possible, car le sérum est injecté. Mais nombreuses sont celles qui arrivent, après plusieurs jours de transport, d'une fabrique lointaine qui ne possède aucun médicament et renvoie consciencieusement à Ravensbrück, en wagons à bestiaux des malheureuses qui étouffent déjà au départ et viennent mourir sur une paillasse de l'infirmerie.
La chambre doit être fermée à clef et dans le noir toute la nuit. Celles qui étouffent et râlent empêchent les autre de dormir. Celles qui meurent tombent de leur lit, font des efforts pour atteindre la fenêtre, espérant y trouver l'air qu'elles cherchent en vain, et butent en mourant sur le lit de leurs camarades. Telles je les trouve le matin, mortes en travers de la pièce, dans l'indifférence des unes et la terreur des autres...